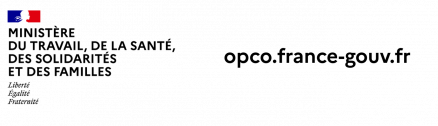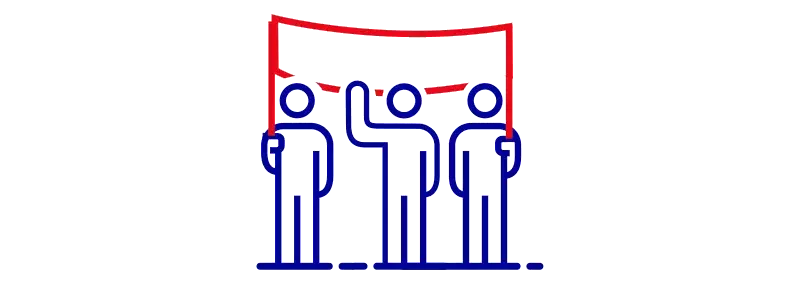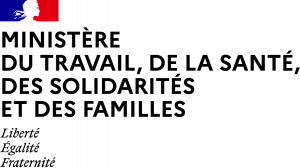Qu’est ce qu’une grève ?
La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et peut être considéré comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
- L’exercice du droit de grève dans les services publics fait l’objet des dispositions spécifiques prévues par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail ;
- Bien qu’elles n’aient pas le statut de salarié, les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables. Cette disposition, issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Des revendications professionnelles
La grève a pour objectif de défendre des revendications professionnelles portant par exemple, sur la rémunération (augmentation de salaire, rétablissement d’une prime,…), les conditions de travail (conditions de chauffage des locaux, moyens de transport), l’horaire ou la durée du travail, la situation de l’emploi (licenciements économiques…), stratégie de l’entreprise (nouvelle politique commerciale…).
La protestation contre des décisions purement politiques (actes du gouvernement, de l’administration) n’est pas un motif légitime de grève. Les salariés qui cesseraient le travail dans ces conditions s’exposeraient à des sanctions. En revanche, caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre national qui constitue une revendication à caractère professionnel (en ce sens, voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2006).
Les revendications doivent être connues de l’employeur (elles peuvent lui être transmises par les grévistes ou un syndicat, voire même par l’inspection du travail) avant le déclenchement du mouvement ou, au plus tard, au moment de l’arrêt de travail. En revanche, une tentative de conciliation n’est pas obligatoire, mais les parties en présence peuvent en prendre l’initiative dans les conditions prévues par le code du travail ou par une procédure conventionnelle de conciliation établie par convention ou accord collectif de travail.
La grève sera considérée comme illicite si l’employeur n’a connaissance des motifs de l’arrêt de travail qu’après le déclenchement du mouvement. Dans ce cas, les salariés qui y participent ne peuvent se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2015).
Un mouvement collectif
La grève doit être suivie par au moins deux salariés. La cessation du travail peut être limitée à une fraction du personnel (un atelier, une catégorie de personnel,…) même minoritaire. Mais l’arrêt de travail d’un seul salarié n’est pas une grève, sauf si son action répond à un mot d’ordre national ou s’il est le seul salarié de l’entreprise.
Quelles sont les conséquences pour le salarié gréviste ?
Le salarié gréviste, dont le contrat de travail est suspendu, subit une diminution de sa rémunération exactement proportionnelle à la durée de la grève. Toutefois, la grève peut entraîner la réduction importante voire la suppression des primes liées à une condition de présence du salarié (prime d’assiduité, de rendement) : ceci est licite à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
- Un accord (ou « protocole ») de fin de grève peut prévoir le paiement de tout ou partie du salaire des grévistes ;
- Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 du Code du travail en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Textes de référence
- Articles L. 2511-1 à L. 2512-5 du Code du travail
- Article L. 344-2-7 du Code de l’action sociale et des familles